Retrouvez la revue en ligne sur le site de l'#Adetem : RFM sur le site de l'Adetem
Retrouver la présentation de la RFM à l'#AMF2015 : La RFM AMF2015
Ce dernier numéro de l’année fait la part belle à deux articles consacrés à la création de nouvelles échelles de mesure. Parce qu’il n’est pas de vérité scientifique sur un phénomène sans une mesure de ses causes, de ses effets ou de ses manifestations, il nous semble important de faire connaître à la communauté marketing les travaux des chercheurs consacrés à la mise au point d’échelles psychométriques de mesure. Nous le savons trop bien, et l’acceptons avec humilité dans notre champ disciplinaire, « la mesure d’une erreur est en même temps la mesure de la vérité correspondante » (Claude Saint Martin, De l’esprit des choses).
Deux articles, plus décalés mais tout aussi sérieux, vous sont ensuite proposés. Le premier porte sur la tendance actuelle à se réclamer, pour les marques, d’un passé nostalgique et pose la question de savoir sur « l’habillage nostalgique » est réellement efficace. Le second aborde un paradoxe apparent : comment explique-t-on l’engouement pour la consommation de substances nuisibles pour la santé, alors même que leurs effets néfastes ne sont pas niés par la cible ? Pour une fois, ce n’est pas la cigarette qui sert de terrain d’expérimentation, mais les boissons énergisantes dont la consommation est en forte croissance auprès des jeunes.
Enfin, dans la tradition d’ouverture que nous avons souhaité poursuivre tout au long de l’année 2015, la rubrique « Fenêtre sur » aborde un thème important en marketing mais dont les enjeux ne se limitent pas stricto sensu à notre champ disciplinaire, celui du mécénat et de la philanthropie, sous un angle un brin provocateur, en posant ouvertement la question de la légitimité de ces concepts pour l’entreprise.
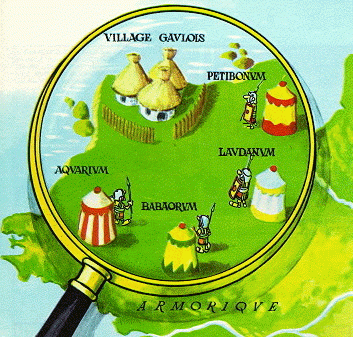 Dans son article, « Construction d’une échelle de mesure de l’expérience narrative réflexive perçue pour les territoires », Laurent Sempé, enseignant chercheur à l’Iut de Périgueux, propose une échelle de mesure à deux dimensions de l’expérience narrative, la convergence des récits et leur résonnance induite. Son terrain d’expérimentation s’appuie sur les lieux et les sites touristiques, prompts à éveiller une expérience narrative riche et intense, qualifiée « d’expérience narrative partagée » lorsqu’elle se diffuse sur les réseaux sociaux. Nul besoin de souligner que « le récit, l’histoire et l’intrigue » sont des piliers essentiels de la production expérientielle. La convergence narrative rend compte de l’imbrication étroite entre le récit porté par l’objet (le site, le lieu touristique) et celui produit par chaque touriste. Elle est portée par l’articulation entre les éléments objectifs du récit (monuments, lieux, musées, etc.) et les éléments subjectifs qui en découlent (mythes, légendes, héros, contes, histoires, etc.). La résonnance narrative prend appui sur les éléments contre-intuitifs du récit qui en renforcent l’impact, une dimension essentiellement étudiée à propos des marques, mais que l’auteur étend aux territoires. La construction d’échelle, qui suit l’exposé théorique des concepts, emprunte un schéma classique et rigoureux, qui permet de valider l’existence des deux dimensions, la convergence et la résonnance. Le recours à une matrice performance-importance permet de hiérarchiser la contribution des dimensions de convergence et de résonnance à l’intention de recommander un lieu touristique et détache le poids essentiel occupé par la résonnance : il s’agit là d’un résultat essentiel pour les managers en charge de la valorisation touristique des territoires.
Dans son article, « Construction d’une échelle de mesure de l’expérience narrative réflexive perçue pour les territoires », Laurent Sempé, enseignant chercheur à l’Iut de Périgueux, propose une échelle de mesure à deux dimensions de l’expérience narrative, la convergence des récits et leur résonnance induite. Son terrain d’expérimentation s’appuie sur les lieux et les sites touristiques, prompts à éveiller une expérience narrative riche et intense, qualifiée « d’expérience narrative partagée » lorsqu’elle se diffuse sur les réseaux sociaux. Nul besoin de souligner que « le récit, l’histoire et l’intrigue » sont des piliers essentiels de la production expérientielle. La convergence narrative rend compte de l’imbrication étroite entre le récit porté par l’objet (le site, le lieu touristique) et celui produit par chaque touriste. Elle est portée par l’articulation entre les éléments objectifs du récit (monuments, lieux, musées, etc.) et les éléments subjectifs qui en découlent (mythes, légendes, héros, contes, histoires, etc.). La résonnance narrative prend appui sur les éléments contre-intuitifs du récit qui en renforcent l’impact, une dimension essentiellement étudiée à propos des marques, mais que l’auteur étend aux territoires. La construction d’échelle, qui suit l’exposé théorique des concepts, emprunte un schéma classique et rigoureux, qui permet de valider l’existence des deux dimensions, la convergence et la résonnance. Le recours à une matrice performance-importance permet de hiérarchiser la contribution des dimensions de convergence et de résonnance à l’intention de recommander un lieu touristique et détache le poids essentiel occupé par la résonnance : il s’agit là d’un résultat essentiel pour les managers en charge de la valorisation touristique des territoires.
 Le deuxième article, consacrée à la mesure, aborde la mesure de la responsabilité sociétale des marques : « une échelle de mesure de la responsabilité sociétale des marques : application aux consommateurs de marques alimentaires biologiques ». Jean-Louis Moulin, professeur à Aix-Marseille et Tarek Abid, doctorant, partent des travaux sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), et en particulier sur le cadre conceptuel proposé par Carroll (1979), pour mettre au point une échelle de mesure de ce construit appliqué aux marques. Les auteurs partent du constat que se réclamer d’une responsabilité sociétale améliore la performance économique et financière des entreprises, car une telle posture constitue un avantage compétitif. L’application aux marques, qui suppose une opérationnalisation du concept de RSE entreprise, est paradoxalement plus rare. La démarche s’appuie sur un fondement normatif (« ce que l’on doit faire ») et instrumental (« comment le faire »), la deuxième composante étant privilégiée dans le cadre de la responsabilité sociétale perçue des marques. Par analogie, si la responsabilité sociétale des entreprises impacte positivement la confiance des citoyens envers l’entreprise, on peut postuler qu’il en est de même de la responsabilité sociétale des marques vis-à-vis des consommateurs. La responsabilité sociétale des marques est exposée dans ses quatre dimensions, la responsabilité philanthropique, le respect de l’environnement, le respect des travailleurs et le respect des consommateurs. L’article nous est apparu particulièrement exemplaire dans la démarche méthodologique adoptée : une pré-enquête qualitative a permis de cerner les dimensions de la responsabilité sociétale des marques, puis a été suivie de deux études quantitatives, exploratoire et confirmatoire, en vue de valider et de fiabiliser l’instrument de mesure. La responsabilité sociétale des marques alimentaires biologiques est mesurée sur les trois dimensions, le respect de la santé, le respect de l’environnement et les activités philanthropiques, tandis que la confiance envers la marque est, elle, mesurée par sa crédibilité, son intégrité et la bienveillance exprimée par le consommateur. Il existe bel et bien une relation significative entre la responsabilité sociétale des marques et la confiance envers celles-ci, confirmant que la responsabilité sociétale, appliquée aux entreprises, peut être utilement déclinée sur les marques elles-mêmes.
Le deuxième article, consacrée à la mesure, aborde la mesure de la responsabilité sociétale des marques : « une échelle de mesure de la responsabilité sociétale des marques : application aux consommateurs de marques alimentaires biologiques ». Jean-Louis Moulin, professeur à Aix-Marseille et Tarek Abid, doctorant, partent des travaux sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), et en particulier sur le cadre conceptuel proposé par Carroll (1979), pour mettre au point une échelle de mesure de ce construit appliqué aux marques. Les auteurs partent du constat que se réclamer d’une responsabilité sociétale améliore la performance économique et financière des entreprises, car une telle posture constitue un avantage compétitif. L’application aux marques, qui suppose une opérationnalisation du concept de RSE entreprise, est paradoxalement plus rare. La démarche s’appuie sur un fondement normatif (« ce que l’on doit faire ») et instrumental (« comment le faire »), la deuxième composante étant privilégiée dans le cadre de la responsabilité sociétale perçue des marques. Par analogie, si la responsabilité sociétale des entreprises impacte positivement la confiance des citoyens envers l’entreprise, on peut postuler qu’il en est de même de la responsabilité sociétale des marques vis-à-vis des consommateurs. La responsabilité sociétale des marques est exposée dans ses quatre dimensions, la responsabilité philanthropique, le respect de l’environnement, le respect des travailleurs et le respect des consommateurs. L’article nous est apparu particulièrement exemplaire dans la démarche méthodologique adoptée : une pré-enquête qualitative a permis de cerner les dimensions de la responsabilité sociétale des marques, puis a été suivie de deux études quantitatives, exploratoire et confirmatoire, en vue de valider et de fiabiliser l’instrument de mesure. La responsabilité sociétale des marques alimentaires biologiques est mesurée sur les trois dimensions, le respect de la santé, le respect de l’environnement et les activités philanthropiques, tandis que la confiance envers la marque est, elle, mesurée par sa crédibilité, son intégrité et la bienveillance exprimée par le consommateur. Il existe bel et bien une relation significative entre la responsabilité sociétale des marques et la confiance envers celles-ci, confirmant que la responsabilité sociétale, appliquée aux entreprises, peut être utilement déclinée sur les marques elles-mêmes.
 Le troisième article porte sur une tendance récurrente du marketing : le « rétro-branding » ou la stratégie marketing qui consiste à mettre à jour un produit du passé en conformité avec des « standards contemporains de goût, de fonctionnement ou de performance ». Alexandra Vignolles, enseignant-chercheur à l’Inseec, poursuit une démonstration empirique de l’impact de la perception nostalgique sur la marque à travers les notions d’attachement, d’attitude à l’égard du produit et de la marque. Une étude réalisée auprès de 342 clients automobiles appuie cette démonstration. Il est vrai que l’automobile est un secteur particulièrement concerné avec le succès de la Fiat 500, de la Mini, de la DS, de la New Beetle et des projets concernant la nouvelle Alpine par exemple. L’habillage nostalgique s’inscrit dans une évocation à résonnance personnelle ou collective, dont il est important de comprendre les mécanismes d’impact sur l’attachement ou l’attitude vis-à-vis de la marque et du produit. Le rétro-branding est en réalité un mécanisme double : d’une part, une référence historique certaine (qui peut être datée mais pas obligatoirement) ; d’autre part, une mise au goût du jour en matière de standards (performance, fonctionnement, goût) de l’objet ainsi revisité. Quatre caractéristiques semblent se retrouver dans tous les objets ainsi valorisés : une allégorie (mythe), une arcadie (une communauté), une aura (essence) et une antinomie (paradoxe, dans la mesure où les marques rétro affichent une incroyable modernité). Le modèle testé postule que la perception nostalgique impacte l’attachement à la marque, et directement ou indirectement via l’attachement à la marque, modifie l’attitude à l’égard du produit et de la marque. La relation entre la perception nostalgique et l’attachement à la marque est bien démontrée, ainsi que son rôle médiateur dans le changement d’attitude vis-à-vis de la marque et du produit. Notons toutefois, que la perception nostalgique n’est probablement pas le seul levier de l’attachement à ces marques, et que la congruence entre l’image du produit et l’image de soi, démontrée dans des études antérieures (Lacoeuilhe, 2000), est un antécédent non négligeable, et la clé du succès réside dans le subtil équilibre entre l’attrait de l’évocation nostalgique et celle que puisent les modèles automobiles ainsi revisités dans un atout fonctionnel indéniable.
Le troisième article porte sur une tendance récurrente du marketing : le « rétro-branding » ou la stratégie marketing qui consiste à mettre à jour un produit du passé en conformité avec des « standards contemporains de goût, de fonctionnement ou de performance ». Alexandra Vignolles, enseignant-chercheur à l’Inseec, poursuit une démonstration empirique de l’impact de la perception nostalgique sur la marque à travers les notions d’attachement, d’attitude à l’égard du produit et de la marque. Une étude réalisée auprès de 342 clients automobiles appuie cette démonstration. Il est vrai que l’automobile est un secteur particulièrement concerné avec le succès de la Fiat 500, de la Mini, de la DS, de la New Beetle et des projets concernant la nouvelle Alpine par exemple. L’habillage nostalgique s’inscrit dans une évocation à résonnance personnelle ou collective, dont il est important de comprendre les mécanismes d’impact sur l’attachement ou l’attitude vis-à-vis de la marque et du produit. Le rétro-branding est en réalité un mécanisme double : d’une part, une référence historique certaine (qui peut être datée mais pas obligatoirement) ; d’autre part, une mise au goût du jour en matière de standards (performance, fonctionnement, goût) de l’objet ainsi revisité. Quatre caractéristiques semblent se retrouver dans tous les objets ainsi valorisés : une allégorie (mythe), une arcadie (une communauté), une aura (essence) et une antinomie (paradoxe, dans la mesure où les marques rétro affichent une incroyable modernité). Le modèle testé postule que la perception nostalgique impacte l’attachement à la marque, et directement ou indirectement via l’attachement à la marque, modifie l’attitude à l’égard du produit et de la marque. La relation entre la perception nostalgique et l’attachement à la marque est bien démontrée, ainsi que son rôle médiateur dans le changement d’attitude vis-à-vis de la marque et du produit. Notons toutefois, que la perception nostalgique n’est probablement pas le seul levier de l’attachement à ces marques, et que la congruence entre l’image du produit et l’image de soi, démontrée dans des études antérieures (Lacoeuilhe, 2000), est un antécédent non négligeable, et la clé du succès réside dans le subtil équilibre entre l’attrait de l’évocation nostalgique et celle que puisent les modèles automobiles ainsi revisités dans un atout fonctionnel indéniable.
 « C’est mauvais pour la santé, mais j’en bois quand même ! ». Un titre provocateur, qui résonne comme la manifestation d’une crise d’adolescents. C’est justement d’adolescents dont nous parlent Florence Loose et Béatrice Siadou-Martin, respectivement maître de conférences à l’université de Montpellier et professeur à l’université de Lorraine. Les deux chercheuses ont choisi de s’intéresser aux différents facteurs cognitifs et psychosociaux qui influencent la consommation des boissons énergisantes chez les étudiants, et ce en dépit des risques avérés de ce produit pour la santé. Le sujet est d’une grande actualité, tant la consommation de produits à risque chez les jeunes est aujourd’hui une des préoccupations sanitaires majeures des pouvoirs publics. Les boissons énergisantes sont montrées du doigt pour leur taux de caféine et de sucre très élevés, deux composants à l’origine de problèmes de santé connus, aggravés par un facteur de dépendance. Or leur pénétration est aujourd’hui comparable à celles des boissons gazeuses auprès des jeunes de tous les pays. Comprendre pourquoi les jeunes consomment des produits dangereux pour la santé suppose d’appréhender leur rapport singulier aux risques et en particulier de s’intéresser aux facteurs suivants : l’attitude vis-à-vis du risque pour la santé, le biais d’optimisme, les normes des pairs, l’hédonisme à court terme et la motivation à préserver son capital de santé à long terme. 239 étudiants d’IUT ont été sélectionnés pour répondre à un questionnaire en ligne. Le modèle final se révèle prédicteur de la consommation de boissons énergisantes, expliquant près de 33% de la variance de cette dernière variable et confirme le pouvoir prédictif des cinq antécédents retenus, l’association la plus forte étant relevée entre les normes des pairs et le niveau de consommation : plus les amis consomment eux-mêmes ces boissons, plus la consommation personnelle est élevée. Au final, et en faisant abstraction du goût même de la boisson sur lequel il est difficile d’intervenir par des messages de prévention, les facteurs cognitifs et psychosociaux jouent un rôle significatif dans la consommation de boissons énergisantes. L’influence du conformisme social est plus particulièrement relevée (même si tous les facteurs identifiés ont un rôle significatif), mettant l’accent sur une voie possible pour les campagnes de prévention contre les risques de santé : marginaliser, en la ringardisant, l’image associée à l’usage de cette boisson précisément auprès de cette cible.
« C’est mauvais pour la santé, mais j’en bois quand même ! ». Un titre provocateur, qui résonne comme la manifestation d’une crise d’adolescents. C’est justement d’adolescents dont nous parlent Florence Loose et Béatrice Siadou-Martin, respectivement maître de conférences à l’université de Montpellier et professeur à l’université de Lorraine. Les deux chercheuses ont choisi de s’intéresser aux différents facteurs cognitifs et psychosociaux qui influencent la consommation des boissons énergisantes chez les étudiants, et ce en dépit des risques avérés de ce produit pour la santé. Le sujet est d’une grande actualité, tant la consommation de produits à risque chez les jeunes est aujourd’hui une des préoccupations sanitaires majeures des pouvoirs publics. Les boissons énergisantes sont montrées du doigt pour leur taux de caféine et de sucre très élevés, deux composants à l’origine de problèmes de santé connus, aggravés par un facteur de dépendance. Or leur pénétration est aujourd’hui comparable à celles des boissons gazeuses auprès des jeunes de tous les pays. Comprendre pourquoi les jeunes consomment des produits dangereux pour la santé suppose d’appréhender leur rapport singulier aux risques et en particulier de s’intéresser aux facteurs suivants : l’attitude vis-à-vis du risque pour la santé, le biais d’optimisme, les normes des pairs, l’hédonisme à court terme et la motivation à préserver son capital de santé à long terme. 239 étudiants d’IUT ont été sélectionnés pour répondre à un questionnaire en ligne. Le modèle final se révèle prédicteur de la consommation de boissons énergisantes, expliquant près de 33% de la variance de cette dernière variable et confirme le pouvoir prédictif des cinq antécédents retenus, l’association la plus forte étant relevée entre les normes des pairs et le niveau de consommation : plus les amis consomment eux-mêmes ces boissons, plus la consommation personnelle est élevée. Au final, et en faisant abstraction du goût même de la boisson sur lequel il est difficile d’intervenir par des messages de prévention, les facteurs cognitifs et psychosociaux jouent un rôle significatif dans la consommation de boissons énergisantes. L’influence du conformisme social est plus particulièrement relevée (même si tous les facteurs identifiés ont un rôle significatif), mettant l’accent sur une voie possible pour les campagnes de prévention contre les risques de santé : marginaliser, en la ringardisant, l’image associée à l’usage de cette boisson précisément auprès de cette cible.
 Le dernier article est lui sur un sujet plus « léger », si tant est que ce terme puisse s’appliquer à un sujet aussi sérieux que le mécénat et la philanthropie. Sylvère Piquet, professeur et Charles Sellen, économiste expert de la philanthropie, nous proposent de réfléchir à la légitimité de ces concepts pour l’entreprise. A l’heure où les grandes marques investissent dans des fondations privées (cf. Fondation Louis Vuitton, dans un bâtiment de l’architecte Frank Gehry), à l’heure de gestes forts, comme celui de Bill Gates, ex CEO de Microsoft choisissant d’investir sa fortune et son temps dans l’aide aux pays déshérités ou, plus récemment, celui de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, qui déclare vouloir céder 99% des actions de sa société à une fondation au nom de sa fille, dans le but de « changer le monde », à l’heure, enfin, où les entreprises communiquent sur le risque écologique majeur auquel est confrontée notre planète, s’intéresser au rôle de l’entreprise dans le soutien aux mécénats et aux actions philanthropiques est plus que jamais d’actualité. S’interroger sur la légitimité des actions de mécénat et de philanthropie pour l’entreprise, revient à questionner la nature de l’entreprise et son rôle dans la société, notamment dans la dynamique du capitalisme (Boltanski et Chiapello, 1999). C’est plus concrètement, se poser la question de la place respective de l’économie et du social dans le développement du marketing. En soulignant les frontières partagées entre le parrainage, le mécénat et la philanthropie, les auteurs mettent l’accent sur la dimension culturelle, trop souvent négligée, de la responsabilité sociétale des entreprises. Ils soulignent également l’enjeu de l’éthique et du politique dans la pensée et la pratique managériale, dès lors que sont abordées les actions de mécénat et de philanthropie. Dans une première partie, les auteurs soulignent que la négation de la fonction sociale de l’entreprise « n’est plus acceptable aujourd’hui », car la firme et la société sont aujourd’hui indissociables et interdépendantes, et les citoyens tiennent « les entreprises et leurs dirigeants pour comptables de leur comportement d’un point de vue social et éthique ». Dans une deuxième partie, les auteurs s’intéressent aux actions de mécénat et de philanthropie en tant que modes de communication dans les stratégies marketing. La philanthropie d’entreprise peut être appréhendée sous un angle utilitariste (intérêt bien compris), stratégique (vecteur d’image) ou rationnel (efficacité économique). Le mécénat, en tant que service rendu à la communauté, doit être efficace, crédible et déterminant, pour se distinguer du simple parrainage ou partenariat. Les auteurs insistent sur la nécessité de lutter contre une tendance récente à confondre mécénat et philanthropie, pour n’en faire que les deux faces d’une même finalité, l’intégration dans la responsabilité sociétale de l’entreprise. En réalité, « le choix entre le mécénat et l’action philanthropique [doit être] dicté par le souci de clarté et de cohérence dans une politique marketing intégré ».
Le dernier article est lui sur un sujet plus « léger », si tant est que ce terme puisse s’appliquer à un sujet aussi sérieux que le mécénat et la philanthropie. Sylvère Piquet, professeur et Charles Sellen, économiste expert de la philanthropie, nous proposent de réfléchir à la légitimité de ces concepts pour l’entreprise. A l’heure où les grandes marques investissent dans des fondations privées (cf. Fondation Louis Vuitton, dans un bâtiment de l’architecte Frank Gehry), à l’heure de gestes forts, comme celui de Bill Gates, ex CEO de Microsoft choisissant d’investir sa fortune et son temps dans l’aide aux pays déshérités ou, plus récemment, celui de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, qui déclare vouloir céder 99% des actions de sa société à une fondation au nom de sa fille, dans le but de « changer le monde », à l’heure, enfin, où les entreprises communiquent sur le risque écologique majeur auquel est confrontée notre planète, s’intéresser au rôle de l’entreprise dans le soutien aux mécénats et aux actions philanthropiques est plus que jamais d’actualité. S’interroger sur la légitimité des actions de mécénat et de philanthropie pour l’entreprise, revient à questionner la nature de l’entreprise et son rôle dans la société, notamment dans la dynamique du capitalisme (Boltanski et Chiapello, 1999). C’est plus concrètement, se poser la question de la place respective de l’économie et du social dans le développement du marketing. En soulignant les frontières partagées entre le parrainage, le mécénat et la philanthropie, les auteurs mettent l’accent sur la dimension culturelle, trop souvent négligée, de la responsabilité sociétale des entreprises. Ils soulignent également l’enjeu de l’éthique et du politique dans la pensée et la pratique managériale, dès lors que sont abordées les actions de mécénat et de philanthropie. Dans une première partie, les auteurs soulignent que la négation de la fonction sociale de l’entreprise « n’est plus acceptable aujourd’hui », car la firme et la société sont aujourd’hui indissociables et interdépendantes, et les citoyens tiennent « les entreprises et leurs dirigeants pour comptables de leur comportement d’un point de vue social et éthique ». Dans une deuxième partie, les auteurs s’intéressent aux actions de mécénat et de philanthropie en tant que modes de communication dans les stratégies marketing. La philanthropie d’entreprise peut être appréhendée sous un angle utilitariste (intérêt bien compris), stratégique (vecteur d’image) ou rationnel (efficacité économique). Le mécénat, en tant que service rendu à la communauté, doit être efficace, crédible et déterminant, pour se distinguer du simple parrainage ou partenariat. Les auteurs insistent sur la nécessité de lutter contre une tendance récente à confondre mécénat et philanthropie, pour n’en faire que les deux faces d’une même finalité, l’intégration dans la responsabilité sociétale de l’entreprise. En réalité, « le choix entre le mécénat et l’action philanthropique [doit être] dicté par le souci de clarté et de cohérence dans une politique marketing intégré ».
Pr Philippe Jourdan et Jean-Claude Pacitto
Rédacteur en chef et Rédacteur en chef adjoint de la RFM / Adetem